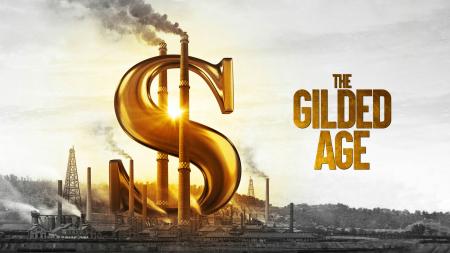Les réseaux sociaux numériques, l’écoute de musique, les jeux vidéo et les séries sont des supports de sociabilité, de divertissement et d’information pour les jeunes. À travers ces activités, adolescentes et adolescents développent une culture commune.
Mais nous aurions tort de penser cette culture comme homogène dans la mesure où les pratiques numériques et médiatiques varient selon les conditions sociales d’existence des individus et leur manière de s’approprier les technologies. Elles dépendent du milieu social, de l’âge, de la place dans la fratrie et font également l’objet d’un marquage sexué.
Le marquage sexué des pratiques culturelles s’explique par des injonctions de genre incarnées dans les produits culturels parmi lesquels les jeux vidéo tiennent la première place sur le marché des industries culturelles. Alors que la moitié des joueurs de jeux de vidéo aujourd’hui sont des filles, dans l’imaginaire collectif le jeu vidéo relève de la culture masculine. Pour autant, féminisation ne veut pas dire absence de différenciation.
Jeux de filles, jeux de garçons
Entre 13 et 15 ans, quel que soit leur milieu social, il existe de fortes différences entre les filles et les garçons en matière de fréquence, de supports et de types de jeux. Pendant leur temps libre, les garçons jouent plus souvent et plus longtemps que les filles. Ils privilégient les consoles de jeux et les ordinateurs pour s’adonner à des jeux de tir et de combat (Call of Duty, Fortnite), de sport et de compétition (principalement de foot comme Fifa), ou leur téléphone pour jouer à Brawl Star, jeu de stratégie et de tir.
Les filles se tournent vers les jeux sur téléphone portable et les consoles à détecteur de mouvement, lesquelles correspondent davantage aux pratiques de loisirs associées au féminin à travers des jeux de simulation et de danse (Just Dance).
Les types de partenaires de jeux diffèrent également : les garçons jouent principalement seuls en modalité multijoueurs en ligne, quand les filles partagent plus souvent cette activité avec un membre de la famille – conséquence de leur socialisation genrée – ou entre copines.
Le poids des stéréotypes de genre pèse ainsi largement sur cette pratique polarisée où chacun, chacune semble se conformer au rôle sexué que la société lui assigne. Les préférences des filles et des garçons sont renforcées par les stratégies marketing des éditeurs de jeux vidéo, qui ciblent explicitement leurs produits selon des normes genrées.
Des transgressions de genre stigmatisées
Néanmoins, les filles jouent aussi à des jeux dits de garçons. Trois raisons peuvent l’expliquer. D’abord, la présence de dimensions symboliques féminines (avatar, personnages féminins) dans certains univers de jeux particulièrement masculinisés qui permet de s’identifier et d’incarner des personnages de son genre.
Ensuite, les filles sont communément plus nombreuses à pratiquer des activités considérées comme masculines. En effet, du fait de l’asymétrie de genre, il est moins dangereux (en termes de risque de stigmatisation, par exemple) pour une fille d’investir un territoire masculin que l’inverse.
« Il y a plus de filles qui vont sur des trucs de garçons que de garçons qui vont sur des trucs de filles », note un adolescent.
Cette remarque traduit l’asymétrie et la hiérarchisation des pratiques vidéoludiques, où l’univers masculin demeure dominant et légitime. Les garçons s’interdisent donc de publiciser une pratique vidéoludique qui relèverait du genre féminin, socialement dévalorisée.
Enfin, la présence d’un frère, d’un père ou encore d’un ami joueur de jeux vidéo favorise fortement l’incursion des filles dans les univers de jeux vidéo masculins, comme l’évoque Ophélie, 13 ans :
« Ce que j’aime bien, c’est quand je joue avec mon frère. »
Toutefois, cette transgression de genre n’est pas sans conséquence pour ces filles. Elles subissent des remarques stigmatisantes, notamment de la part des garçons : « D’accord, vous êtes des mecs. » Qu’elles jouent à des jeux dits de filles ou de garçons, leurs pratiques sont le plus souvent disqualifiées par les garçons.
Lors d’une enquête au cours de laquelle des adolescentes et des adolescents étaient réunis pour parler de leur pratique vidéoludique, celle des premières est particulièrement dénigrée par les seconds : ils monopolisent et coupent la parole, prennent la posture d’expert du sujet, ridiculisent les jeux associés aux filles en les réduisant à quelques clichés : « Des jeux pour des enfants sages », dit l’un, quand un autre considère que « c’est pas très intéressant pour les garçons de nettoyer les bébés et de traire les vaches ».
Les filles justifient leur pratique en la dévalorisant
De leur côté, les filles n’évoquent pas aisément jouer aux jeux vidéo : dire et assumer sa pratique est conditionné à sa dévalorisation. Elles sous-estiment la qualité du jeu (« C’est des petits jeux »), leur niveau de compétences (« Je suis nulle ») ou leur engagement dans les jeux (« C’est juste pour rigoler »).
Par ailleurs, la présence d’un tiers masculin dans l’environnement proche permet aussi de justifier sa pratique. Louisa, par exemple, déclare jouer uniquement lorsqu’elle va chez son frère aîné, se dédouanant ainsi d’une pratique personnelle quotidienne. Elle justifie sa pratique de Call of Duty et de Grand Theft Auto en précisant que ces jeux ne lui appartiennent pas.
La dévalorisation de la pratique rend ainsi possible sa publicisation à travers ce devoir permanent de justification qui s’explique par une incorporation des hiérarchies de sexe et des valorisations symboliques inégales qui y sont associées.
En définitive, l’analyse des pratiques vidéoludiques des adolescents de 13 à 15 ans met en évidence des persistances : celle des différenciations genrées dans les pratiques de loisirs (sportifs, culturels, etc.), celle de la construction symbolique des espaces du féminin et du masculin et celle de la hiérarchisation des rapports sociaux de sexe.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.